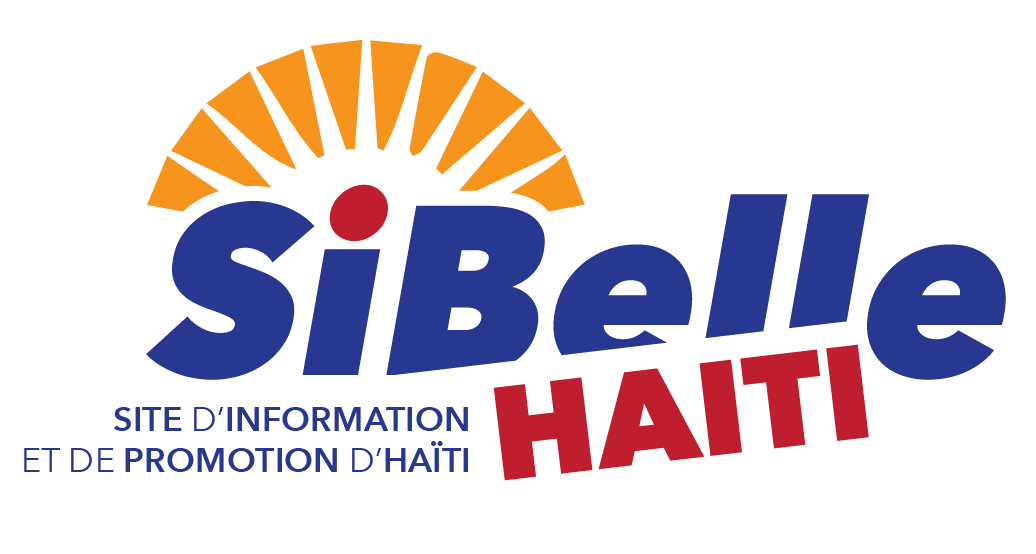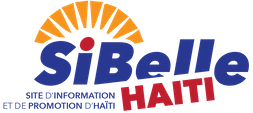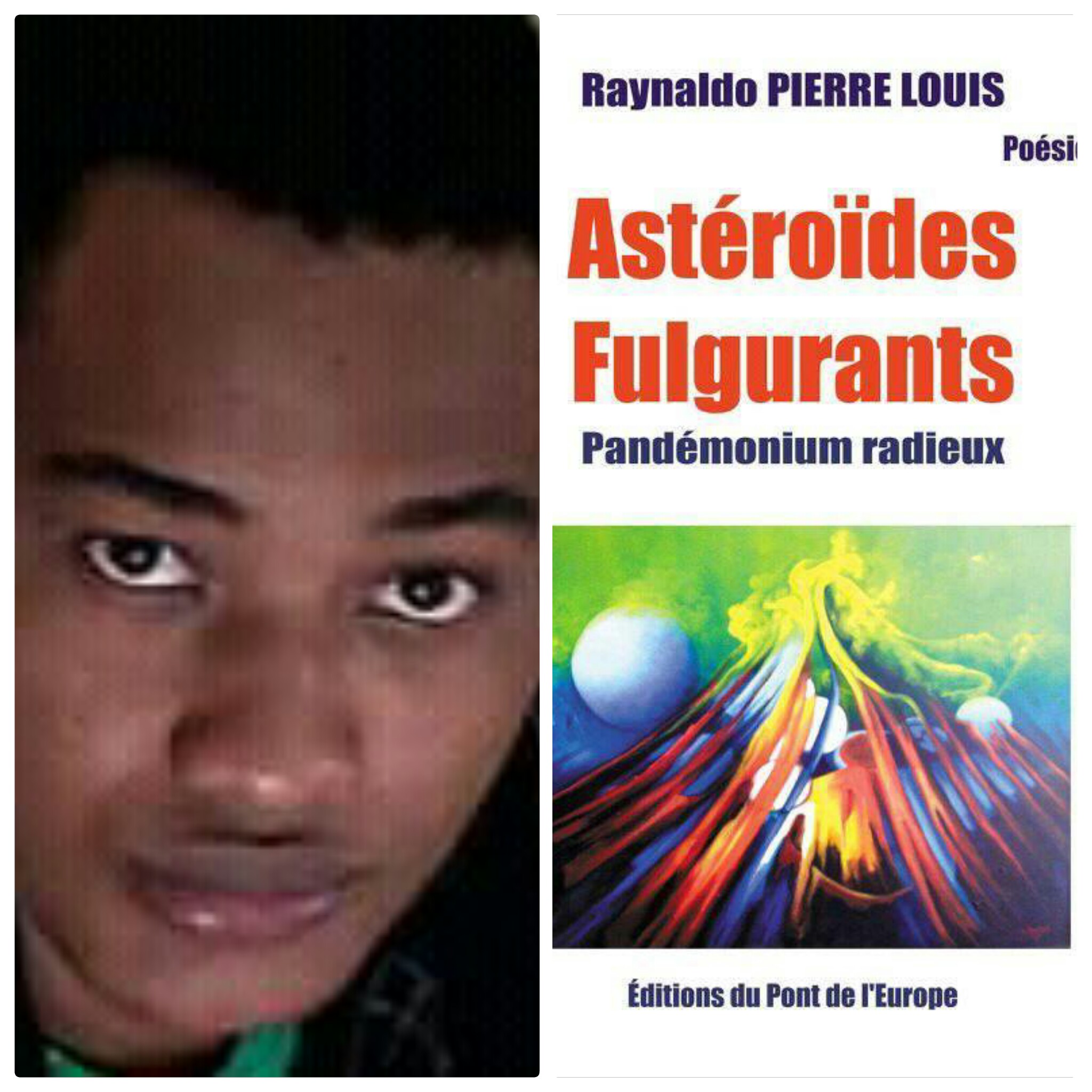Par Julien MIAVRIL
Poète et philosophe français
Strasbourg, mai 2019
« Les poètes nous ravivent et nous rallument de leur grand feu intérieur qui pétille intensément ».
Nous citons ici Raynaldo PIERRE LOUIS plus singulièrement qu’aucun autre. Il y a en effet dans ces « Astéroïdes Fulgurants » comme dans ce « Pandémonium radieux » plus encore peut-être que le désir de cueillir la lumière avant qu’elle n’éclate en une splendide traînée d’astéroïdes et d’éclairs fulgurants (comment ne pas y entendre René Char qui rappelle que « si nous habitons un éclair, il est le cœur de l’éternel »), celui d’offrir dans un élan à la fois orphique et prométhéen le feu intérieur et poétique aux ténèbres afin qu’y rayonne cette lumière dont même les démons ne peuvent se détourner : celle du verbe vivant qui avec ferveur s’irise et dans toutes les directions se diffracte, y compris en venant se loger au cœur de ce pandémonium réfractaire à toute clarté. Rien qu’avec ce titre à la beauté puissamment évocatrice, Raynaldo condense métaphoriquement ce qui fait l’essence de toute œuvre et de toute quête poétiques authentiques.
Le recueil s’ouvre sur un poème placé sous le signe de la dualité, celle de « l’être mythique » qui n’est rien de moins que la femme originelle, minérale et matricielle à la beauté aussi « majestueuse » que « monstrueuse ». Femme initiatrice qui fait entrer son poète élu dans « le banquet du monde » en même temps qu’elle précipite sa chute, non sans s’être nourrie au préalable des « pierres sanglantes » qui tapissent le fond des « abîmes ». Et non sans avoir voué aux abysses, puisque faut-il rappeler qu’elle règne sur la mer et sur l’ensemble des sirènes tentatrices et meurtrières, quelques « voyageurs » imprudents. Cette femme offre ainsi au poète un amour aussi sublime que violent et déchirant. A moins qu’elle ne se contente d’annoncer la venue de cette « fille en transit » dans les « songes » du poète qui suit aussitôt. Et avec elle nous le verrons, le poète touche au sublime.
C’est précisément parce que le poète ignore tout de l’origine et de la provenance de cette fille, « j’ignore qui tu es, j’ignore d’où tu viens », que le miracle de l’amour et celui du poème ne font plus qu’un au seuil même du mystère. Cette fille incarne en effet l’indomptable puissance du féminin sacré : « Ange. Démon. Diablesse. Sorcière maléfique surgissant des ombres nocturnes catapultées du Tartare ». Elle puise sa force directement à la source du royaume des ombres pour s’offrir comme cette « fulgurance fatale d’un ciel déchiré ». « Reine des enfers ! Perséphone de mon île fermée », elle est cette Lilith sombre et éclatante, amoureuse et dévorante, résolument libre de toute entrave, et dont le pouvoir sans limite fascine au moins autant qu’il inquiète. Cette « Reine des enfers » est celle-même que Rimbaud a sans doute au moins entrevu au cours de sa propre traversée. Mais Raynaldo précise que cette part d’ombre et de ténèbres se marie de manière troublante à la resplendissante lumière des étoiles. Toute Perséphone qu’elle est, cette femme n’en reste pas moins cette « fille des nues, étoile grotesque, accrochée au ciel de bronze ». Fille des nues qui détient le pouvoir de « bénir les dieux » et qui porte dans son regard « la voie lactée qui brûle la planète entière ». Mais cette muse magmatique, énigmatique et fatale ne tarde pas à entraîner le poète dans une « Ultime quête sadomasochiste par-delà le Styx ».
Et aussitôt, nous sommes placés en présence d’un feu d’artifice verbal, sonore et imaginal. Chorale ou fanfare, « orchestre si funeste de Satan ? » Mise en branle et branle-bas de combat secrètement chorégraphiée de signifiants qui s’entrechoquent selon cette mystérieuse loi de l’alchimie du verbe ? Difficile de ne pas y entendre un écho fait à cette « parade sauvage » dont on pensait que Rimbaud seul détenait la clef. Tout fuse ici et tout infuse dans le miracle explosif de ce « big-bang magique » qui entraîne le poète dans un concert de visions fantastiques et « fantasmatiques » où le chaos primitif n’est plus l’opposé de l’ordre principiel, mais où il devient la source et l’aliment de toutes les fantasmagories. Car le poète ne chante pas la douleur de ne pas pouvoir aimer, mais précisément celle de ne pouvoir aimer que dans l’intensité la plus éprouvante. Le prix à payer ne peut donc qu’être le plus élevé qui soit : « Le poème : une tour virtuelle que je gravite dans sa plus haute cime pour me jeter à l’envers dans les falaises du monde ». Suicide fantasmatique et romantique d’un poète qui aura consenti à aller jusqu’au bout de sa « périlleuse aventure ».
Quête amoureuse et quête poétique, nous y reviendrons, ne sont qu’une seule et même quête chez Raynaldo Pierre Louis. Aussi, il n’y a point de hasard à ce que son recueil s’ouvre sur ce triptyque fondateur. Il est important de rappeler que je n’ai pas la prétention de procéder à une étude systématique de l’œuvre du poète. Et je ne doute pas que dans un avenir proche, les poèmes de Raynaldo seront lus et commentés par de bien meilleurs herméneutes que je ne le serai jamais moi-même. Mais j’entends au moins ici offrir une amorce de réception critique sans pour autant trahir l’esprit de l’œuvre en question. Je poursuivrai donc en évoquant certains des poèmes qui m’ont le plus marqué bien qu’aucun ne m’ait laissé indifférent.
Le suivant, « Comme une preuve d’idolâtre » s’ouvre sur des vers en créole et se conclue par des vers en français. Il rappelle ainsi que le poète se tient au carrefour de deux idiomes et qu’il serait bien vain de disqualifier le créole au prétexte que notre langue s’est imposée comme la langue officielle. « Pour avoir trop chanté la chanson qui envoûte la vie », le poète ne peut que réaffirmer sa double appartenance culturelle et linguistique qui fait la richesse et la singularité de son rapport au monde. La femme et le poète se confondent ici avec le lieu évoqué. L’union des corps et du décor est totale. Le surgissement de la femme aimée est en effet vécu comme celui de l’aurore boréale. Elle n’est plus cette fois celle qui meurtrit et qui aliène, mais celle qui libère et qui offre le salut rédempteur. Elle est celle pour laquelle le poète nourrit cette adoration révérencielle qui inspire et nourrit son « rêve pluriel ». Aussi lui offre-t-il, « comme une preuve d’idolâtre », la « clef » dont on comprend qu’elle est celle de son amour. L’érotisme ici n’est plus celui des trois précédents poèmes. Il ne se traduit plus en effet par l’action d’un feu irrépressible, total et dévorant, mais il s’exprime par le libre consentement à l’abandon. Il est allégeance faîte à cette « marchande de liberté ».
Et ce qui succède à cette expérience de l’amour est celle de l’absurde et de la révolte, dans le sillage d’un Camus, qui s’en suit. « Vanité des vanités, tout n’est que vanité ! » Quel poète ne s’est jamais demandé en effet si écrire de la poésie avait réellement un sens dans un monde qui semble davantage se complaire dans le nihilisme que dans l’enthousiasme fertile. Quel poète ne s’est jamais senti être le « somnambule d’un rêve inaccompli » ou cette « page errante allumée au souffle de l’abîme », ce réceptacle qui ne reçoit rien d’autre que le silence indifférent et le vide abyssal du cosmos, cette « rature migratrice » plus paralytique encore que ne le sera jamais son propre poème laissé vacant. L’angoisse existentielle se conjugue ici en effet à celle de la page blanche : l’âme du poète est parfois aussi vaine et dépeuplée que son propre manuscrit qui en est le reflet. Car il en va toujours, au bout du compte, de la mort et de la perte, de cette mort qui « chevauche son rêve tel despote », ce seul souverain dont l’empire n’a jamais eu à diminuer ou à accroître plus qu’il ne l’est depuis l’origine. Cette mort implacable qui finit toujours par entraîner le poète et son poème au « plus dense de la nuit ».
Et si rien ne sert de se révolter contre elle, tout ici-bas pousse au contraire le poète à exprimer sa rage de damné, lui dont la vie n’est que « crachat, éclaboussures, tourbillons de poussières mêlées d’azur ». Et cette éruption organique est bien ce qui ouvre l’espace du chant. Car tout en effet reste « possible sur les rivages de l’encre, par la voie/voix de l’imaginaire ». L’écriture devient d’abord le moyen de libérer notre animalité sauvage et primitive, cette part de nous-même qui par le travail du refoulement a été domestiquée et châtrée pour complaire à la société des hommes. Honneur est ainsi rendu par le poète à cette « chienne qui m’aboie » avant qu’il ne « pisse au visage de l’homme » et le couvre « d’immondices » en « place publique ». Cet homme qui est le produit d’une civilisation purement artificielle, mécanique et dévastatrice. Et pour cela « tous les éléments de la nature et tous les sentiments de l’homme sont conviés » pour servir à la réalisation d’un immense rite conjuratoire et cosmique qui vise à redonner à l’homme et à la terre « la paix, la haine, la guerre, l’amour » et ainsi favoriser leur totale renaissance.
Plus loin, le poète nous éclaire quant à son but supposé réel :
« Je prolonge
les fulgurances des songes
revigore les voix/voies du vide
dans la gorge enflammée du poème »
Ne venait-il pas de préciser juste avant que son poème est celui « d’un homme qui joue avec son ombre », autrement dit, celui d’un homme qui tourne le dos au soleil pour mieux quêter la trace de ce feu qui nourrit les hantises et qui voue l’être en quête d’unité au dédoublement, à la dispersion voire au multiple ? Et la réponse ne se lit-elle pas au revers de l’éclat évanescent des songes fulgurants ? Là même où le vide fait entendre sa chorale, là même en somme où le poème ne peut faire émerger un chant des profondeurs de sa gorge sans que celle-ci ne s’enflamme puis se consume, laissant ainsi le poète en récolter les cendres encore brûlantes ? Tout poème ne serait-il pas qu’un tas de cendres au regard du feu qui l’a vu naître ? Autant de questions qui forment ces « mystères scellés dans le vent », ces « arcanes énigmes labyrinthes » dont le poète nous entretient un peu plus loin. Et la seule au fond qui pourrait encore nous guider au terme de cette traversée périlleuse du labyrinthe irradie par son absence : « Ariane, où es-tu ? » . Solitude souveraine du poète qui n’est pas loin de se confondre avec cette « carcasse d’oiseau » dont la « signature » même est « fragmentée ». « Folies rationnelles » et « Archéoptéryx » se font ainsi écho : l’oiseau fossile privé de ses ailes ressemble à celui dont les ailes de géant l’empêchent de marcher : l’un et l’autre payent ainsi le prix d’une démesure dont le logos échoue à conjurer le malheur.
Le poète qui « rêve d’un ciel crevé d’éclairs » confie ainsi dans son poème « Oxymores giratoires » être ce « poète perdu dans la turbulence des mots ». Les mots prennent toujours de vitesse et un poème n’est rien d’autre peut-être au fond que la transposition hallucinée de ce vertige. Plus loin, Raynaldo évoque ainsi ce mouvement de « slalom » qui voue le poète à n’être rien d’autre qu’un « burlesque artisan du siècle », un « jongleur saltimbanque » qui tel un équilibriste, traverse sur un fil l’abîme d’où les mots ont jailli et où il menace de chuter comme happé par le tourbillon invisible du vide. Et pourtant, le poète n’est pas fatalement condamné à l’errance ou à la chute. Et son salut, nous dit Raynaldo, réside dans le retour à cet océan primordial que gouverne Thétis, « nymphe marine à la belle chevelure », détentrice d’une « clef » qui est doublement celle de l’océan et celle du salut. Le poète doit être prêt pour cela à défier et à « brocarder tous les dieux de la mer », c’est à dire tous ces dieux masculins qui pourraient lui disputer son droit de s’unir à Thétis, reine de toutes ces sirènes qui inspirent aux poètes tous leurs plus beaux chants. Une nouvelle fois, c’est donc l’élément de la féminité qui porte et apporte la promesse d’une libération et c’est bien à travers l’ivresse charnelle et sensuelle que le poète se rend maître de sa propre ivresse verbale et poétique.
Ainsi avec « Effervescences magiques » et tous les poèmes qui suivent (à l’exception peut-être de « Ratures sensorielles de la dernière plume indécise »), le poème revendique pleinement son droit à vivre son « rêve incommensurable » au moyen de tous les « émerveillements, enchantements » possibles. On y sent combien le Rimbaud des « Illuminations » est présent sans que Raynaldo ne perde pour autant tout ce qui fait l’absolue singularité de son écriture. Les visions s’enchaînent et se multiplient à mesure que se déploie ce « kaléidoscope » (qui donne son titre à un autre recueil de Raynaldo présent au sein de cette anthologie, « Kaléidoscope de couleurs fauves », mais que nous ne commenterons pas ici) vivant dont on sent que les combinaisons sont inépuisables et infinies. A mesure que la menace de l’abîme s’éloigne, ce sont tous ces « élans vertigineux vers la lumière » qui finissent par culminer au sein des poèmes pour en faire des « chandelles magiques-mystiques allumées dans l’ombre ». Le pandémonium originel se change ainsi en jardin d’Éden où flamboient « les lucioles, les nébuleuses, les protubérances lunaires » et la « magique constellation » dont rêve en secret le poète. Le poète touche et atteint enfin la cime qui motivait son « envol d’aigle fulgurant ». « Albatros ivre de son vol lointain », il a enfin tout loisir de se perdre « dans les nuées du délire ». Délire dont il n’est plus besoin ici de se prémunir mais qu’il convient au contraire d’assumer pleinement pour mieux en recevoir la part fertile. Le scandale lui-même en devient « jubilatoire ». Son ange noir, nécessairement poète, recouvre enfin son pouvoir de féconder la nuit :
« Le scandale est là Dedans mon poème… Ô grossesse sidérale A écorcher la nuit »
Et le poète, au terme de cette grandiose épopée, peut enfin se laisser emporter par cette mer (« ô vague, vague, vague, la vague du poème m’emporte…»), reflet terrestre de l’éternité, où il sera enfin reconnu roi au milieu des dieux et des nymphes…
En définitive, je n’ai évoqué ici que la « Spirale de l’absurde » qui est le premier des quatre recueils composant cette anthologie. Les trois autres, tout aussi beaux, puissants et riches, auraient bien sûr mérité un examen au moins similaire. Je remets à plus tard une telle entreprise, entreprise ô combien nécessaire qui consiste pour l’essentiel à faire connaître la poésie de l’un des plus grands poètes de ce siècle et même au-delà. Il faut remercier ici l’éditeur de ces textes, les éditions du Pont de l’Europe, qui œuvre en effet courageusement à promouvoir et à diffuser la poésie haïtienne, comptant bien sûr d’autres très grands auteurs à l’honneur sur son catalogue. Raynaldo se distingue néanmoins par une qualité d’écriture dont la portée est sans aucun doute universelle et dont la stupéfiante beauté se singularise par l’équilibre tout alchimique trouvé entre l’ombre et la lumière et par le recours à des images qui relèvent proprement de l’expérience et de la vision mystique. Une poésie qui s’inscrit ainsi de plein droit dans la filiation de l’œuvre rimbaldienne et qui se propose d’en continuer, voire d’en parachever l’art de la voyance. Mais au-delà de ce trait métaphysique très fort, la poésie de Raynaldo culmine en fait dans l’expérience amoureuse. Chez Raynaldo plus fortement encore que chez nombre d’autres poètes, la quête amoureuse est quête de la totalité, d’un absolu d’autant plus désiré qu’il se dérobe sans cesse. L’union que vise le poète avec l’être aimé est aussi désir de fusion avec le cosmos et avec le tout. Toutefois, l’être aimé n’en reste pas moins absolument unique et singulier, et c’est précisément cette singularité que le poète chante de manière exemplaire. De même, le poète adoube son amante au moyen du verbe : il lui rend ce souverain pouvoir que des siècles et des siècles d’oppression lui avaient confisqué et lui confisquent encore. Une nouvelle fois, Raynaldo semble avoir fait sien ce commandement rimbaldien : « Il faut réinventer l’amour ».
Mais puisque je ne souhaite pas trop en dire au risque de mal dire, je conclurai avec l’idée que Raynaldo est au nombre de ces poètes qui nous disent que re-poétiser notre rapport au monde suppose de s’extirper de la gaine du matérialisme ; cette gaine devenue toute puissante et tellement étouffante pour le corps vivant et sclérosante pour l’âme. Sous bien des aspects, son recueil s’impose comme une tentative bien sûr réussie de resacralisation d’un monde qui continue de profaner la nature dont il dépend pourtant entièrement. Ce même monde qui, de fait, n’a plus une seconde à accorder à la lecture de ses poètes. Et sans jamais prétendre pouvoir épuiser le sens d’une œuvre qui en est riche au-delà de toute mesure, j’espère tout de même, lecteur, t’avoir donné envie de lire et d’approfondir ton lien à ces « Astéroïdes Fulgurants » dont tu dois te préparer à recevoir l’éclat comme un choc de toute première ampleur.