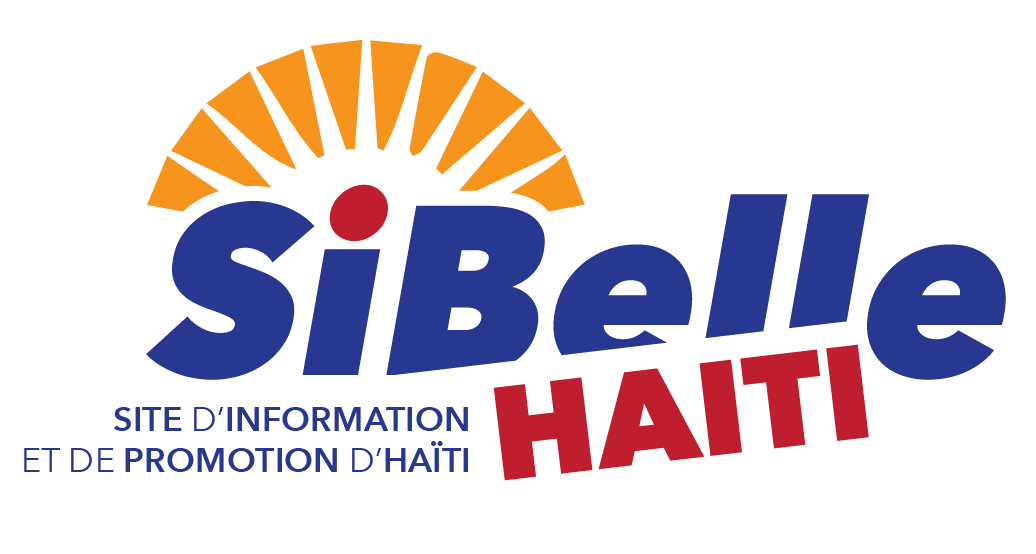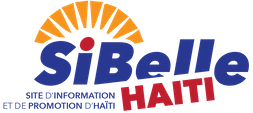Par Mehdi E. Chalmers
“On a donné beaucoup de définitions de la poésie. Mais une chose est sûre, c’est que son domaine se circonscrit dans l’authentique.”[2]
Avec quoi l’on compose
J’adresse ces réflexions aux écrivains et aux lecteurs haïtiens, Beaucoup a été dit en effet sur la poésie et le poète. Si nous nous contentions de la simplicité performative nous dirions avec Césaire : “Il faut que la poésie soit. C’est tout.”[3], ou bien avec Nietzsche (que Césaire connaît comme un frère) dire que le poète n’est que ce qu’il est : “Rien que Bouffon, rien que poète…”. Et puis se mettre à en écrire, et puis apprendre l’humilité : se dire que l’importance de ce poète, dans sa grandeur, dans la cité, est simplement celle de ce Bouffon, qui au sommet de sa noblesse ne fait que rappeler aux hommes leur vanité, sans oublier la sienne. Conscience de vanité, mais présence, encore plus quand on pille, qu’on affame, qu’on tue, autour de nous, et que nous tous tremblons un peu, même les plus téméraires, même ceux qui calculent méticuleusement leurs combats avec ruse et colère, en masse de pierres, litres d’essence…. en attendant. Je mets ces réflexions sur la poésie nationale, sous le parrainage du poète qui opérait sa conversion vers le pays natal avec dureté et pur amour, et de cet autre qui disait détester son pays, sa nation, tout en parlant à ces Allemands haïs, car il savait qu’il était trop tard pour eux, mais leur parlait, pour le leur dire, qu’il était tard.
Si la littérature a son importance dans la fabrication de l’Histoire d’Haïti, il n’est pas possible de penser l’écriture haïtienne en niant le rôle des collectifs – le plus consacré, en portant la preuve, est Haïti Littéraire – parce que les histoires, on ne se les raconte pas tout seul. Il y a une histoire des groupes poétiques en Haïti, qui ferait un livre entier. Me suis lié pour ma part à l’Atelier Jeudi Soir – le groupe et l’éditeur – qui publie des textes de membres comme Jeudi Inéma, Mélissa Béralus, David Jean, Lorvens Aurélien, Henri Kénol, Helène Mauduit, Marc-Endy Simon, parfois des collectifs, et aussi des non-membres, Pierre Richard Narcisse, Georges Castera, Néhémy Pierre-Dahomey etc. Une communauté d’artistes ancrée dans l’espace, c’est ce que cherche l’Atelier. Il n’y a pas que des poètes à l’Atelier, mais s’y forme pas mal de poètes. Je dis s’y forme pas au sens d’une école mais au sens où se former soi-même à une activité, à un métier, à une passion, cela requiert un lieu d’échange et d’apprentissage, informel et formel, qui pourrait être le salon d’un ami, ou un bar, ou une place, où un travail se fait, assidu et inlassable. C’est la manière dont les personnes font d’un espace commun lambda, un lieu reconnaissable de production. Ce que c’est disposer d’un poème sur la place publique, se mesure déjà au baptême du feu des jugements exigeants des acolytes en écriture. Ils nous font voir nos tics, nos fautes, nos idioties et nos réussites. Ils affinent notre oreille interne afin que nous puissions produire parfois des choses de valeur. On les écoute dans le risque d’être évalués par des esprits qui cultivent un souci de l’autre. Les écrivains/lecteurs qui se sont croisés à bibliothèque Justin Lhérisson peuvent dire quelque chose de ce qu’un tel échange apporte. C’est aussi le rôle de Sosyete Koukouy, d’Araka, du Petit Conservatoire, du Centre Pen, c’est le rôle créateur des troupes comme NOUS ou la BIT. En absence d’une écoute soucieuse et solidaire les talents ne peuvent que mourir. Aucun poème ne naît sur une terre de solitude. C’est un mythe.
Ce qu’on a de beau se partage. Ce qu’on offre doit être beau. Et la poésie est belle. Ça, ce n’est pas un mythe. Elle est faite pour l’amour. Les tentatives modernes d’évacuer cette beauté n’ont pu qu’échouer. Amère jusqu’à cybernétique, elle se reconfigure toujours, la beauté. La poésie compose un geste qui préfigure l’aimer concret. Cette beauté a pour fonction d’ouvrir nos sens à la présence atomisée du monde. Une œuvre poétique achevée est un haut-lieu de ralliement qui fait voir plus de ce monde que ne pourrions depuis la plaine. La haute-terre questionne l’horizon. Elle nous dicte une cadence et une exploration à renouveler. Les œuvres bien faites disent une exploration réitérable par le lecteur. Il doit se perdre dans les déchirures du dialecte d’un artiste qui vaudra la peine de malentendus. Mais de peine perdue. Perdue parmi les hommes, les drames, les peuples, les dieux, les arbres, les lieux. De sorte que les existences paraissent dans ce fouillis visible, étoffe unie d’apparence, où les fils se cachent pour montrer les couleurs : ce que fait Les cinq lettres de Georges Castera, recueil parfait, ou Idem de Davertige.
On se croit cette chanson intérieure qui change à notre insu ; un air qui accompagne et qu’on essaye de suivre pour vivre. Cet air n’est ni de moi, ni du monde, mais dans le monde. Le poète y est un animal bizarre, il fait des bruits qui signifient plus que le langage habituel, qui cherchent à recréer la geste d’une première adresse qui unifia un groupe d’hommes en confrères. On décide un jour, comme pleins de jeunes gens haïtiens, qui savent plus ou moins écrire dans leurs deux langues, que l’écriture était une sorte de manière de vivre. Avec pas mal de confusion dans cette décision. Ce qu’on appelle une vocation, au lieu de dire métier. On dit ça quand le métier ne nourrit probablement pas, ou secondairement, accidentellement, on dit ça quand on sait que ça existe, et doit même exister, mais que le pourquoi de cette existence ne va pas de soi, c’est-à-dire que sa fonction est un peu plus mystérieuse que l’utilité fondamentale et immédiate d’un cordonnier, d’un comptable, ou d’un expert en communication, ou du très nécessaire homme politique dans l’État que nous subissons depuis plus de deux siècles, de l’avoir conquis souverain. Je veux dire vocation, plus ou moins d’artiste, si on veut, mais poète en ce qui me concerne, puisque l’activité du poème est ce qui m’intéresse.
Poème obligé ou poème par défaut
J’assume que le poème est la forme la plus générale de la proposition esthétique. Les autres genres sont des hypostases, des retombées du poème. Ce que l’histoire de la poésie confirme selon moi : l’humain commence par créer une parole spéciale, collective, qui tend vers des possessions et des émotions intensément vraies, puisque que ce qui nous unit tous c’est la parole. Après, on crée des choses un peu plus particulières.
Si on prend le genre le plus originaire de l’art haïtien, la mélodie vaudou c’est l’élément premier. Si on affirme l’indépendance de la parole par rapport au chanté, on commence à trouver du poétique strict, ce qui arrive presque toujours dans l’histoire des peuples, avec le conte, et ici peut-être le lodyans, quoique ce soit un genre encore en cours de réalisation… le poème domine finalement les pratiques, par sa solennité simple… par sa charge historique.
Faubert Bolivar – poète et dramaturge de marque – m’a partagé il y a quelques temps une théorie fascinante et très sombre sur une certaine prévalence de l’écriture poétique dans notre pays. Il pense que c’est le manque de Langage, et de Pays même, qui rend populaire la poésie, le manque de temps à soi, d’espace à soi, de lieu… le manque d’air, que c’est ce qui fait privilégier la forme relativement brève et cassée de la poésie, celle qu’on trouve ici, en tout cas celle d’une génération qui s’y est engouffrée, et que le poème prolifère selon lui là où il n’y a pas de cité, pas de citoyenneté ! La thèse m’a longuement intrigué après notre conversation. Mais, pour profonde que je la trouve et indicative d’une voie d’analyse puissante, je ne peux pas l’accepter. Elle ne peut pas résumer l’état des choses de ces vingt, cinquante, ni cent dernières années. Car, on arrive au poème avant tout par le poème, par l’histoire des poèmes, ou par la chanson, et on se prend au poème, puis on se prend pour un poète, parce que le poème donne avant tout l’impression d’un rituel capable de réaliser quelque chose, comme montrer notre amour pour une femme ou un homme, comme révéler une fracture du monde. Ce n’est pas un manque de Langage et de Pays qui fait ça, c’est la présence de poèmes avant nous qui montre cette possibilité de liberté et de transcendance. L’aspiration vers la liberté et la transcendance se fait plus forte lorsque ces choses sont sous attaques.
Le poème est la parole libre et transcendante. La narration, elle, est une voie particulière de la Parole, toujours chantante quand elle est pleine d’elle-même. La narration aussi est toujours là en littérature, parce que tout ce qu’on dit énonce un décor, un récit, une personne, mais un poème c’est de la narration qui s’affirme ou qui s’efface. C’est plus large. De même que l’incarnation par le jeu théâtral est une voie particulière de la parole poétique, car tout poème est aussi jeu et performance possible. Ce qu’on appelle le poème est une forme qui se reconnaît indépendamment des catégories du genre, qu’on décide de créer, même si les taxinomies sont bien pratiques pour se repérer dans une bibliothèque. En réalité les règles d’un genre peuvent toujours se retrouver dans un poème passé… la prophétie vient en poème, le tragique vient en poème, le policier, la science-fiction même qui est une sorte de merveilleux rationaliste vient de poème[4]. Poème : ce qui possède un dire, ce qui raconte quelque chose, ou qui pas tout à fait “raconte” mais “raconte” quand même. Bien avant le poème en prose, le vers à la ligne n’a rien d’une essence du poème, qu’il soit libre, ou pas, c’est un marqueur plus ou moins fin, plus ou moins grossier, un simple outil pratique pour jouer avec le rythme visuel ou sonore de la parole, c’est plutôt un signal pour que le lecteur ou l’auditeur ne se sente pas confondu et trompé. On y trouve fort peu pour s’expliquer la valeur d’un poème en tout cas. Ce qu’on cherche c’est l’originaire timbre scandé qui signifie que je représente un sujet parlant, une vraie personne, qui peut être moi ou vous ou quelqu’un d’autre, s’adressant à tous, pour être reconnu humain, un être mélodique, ce qui fait le propre du sentiment esthétique en poésie, mais qui traverse aussi tout texte réussi.
Comme partout ailleurs, une écriture porte son adresse, Haïti-Caraïbes, et dit sa communauté, kay vwazen, comme dirait Inéma, la condition de son existence. Cette adresse est nécessaire pour habiter et pour traverser la mer. Écrire en Haïti c’est bien sûr se retrouver fourré dans une tradition, un commun. Baudelaire signale dans ces Fusées : “Avis aux non-communistes : tout est commun, même Dieu!” Ce qui pourrait vouloir dire pour moi, tout est commun, même le Verbe, donc la poésie. On trouve ce genre de “verbe” mythifiant dans la phrase de Dessalines inscrite par Boisrond Tonnerre “le sang français lugubre encore nos contrées” qui est phrase poétique par excellence. Rythme, corps sonore, création de langage et production de sens et de mythe : tout y est déjà ! Avec une violence d’époque, mais qu’on comprend assez facilement, ça te force à comprendre, même sans connaître bien l’Histoire.
Un poème fraye vers une écoute de soi et d’un autre qui entend, il doit forcer celui qui le reçoit à se mettre dans la voix qui parle. Il faut que ce qui se passe soit supra-individuel pour nous intéresser, et tout supra-individuel en poésie est de l’épique, de l’Iliade jusqu’à Ogun Abibiman de Wole Soyinka, il y a un épique strict. Mais l’épique est plus qu’un genre. Il a ce caractère fondationnel du groupe. Primitivement il doit être élu par le groupe, pour le groupe. Donc le lyrique n’est pas originaire. Lyrique, le Moi gonflé de son chant qui le distingue dans la foule, c’est le moment d’individuation de l’épique. La voix devient d’une personne particulière, alors que l’épique c’est ce qui rassemble au Départ. Or pour se faire voir parmi les autres, l’homme lyrique doit s’augmenter, pour qu’on reconnaisse sa singularité fascinante, son chant doit être plus grand qu’un tout petit-moi qui raconte ses histoires de cœur. Ça doit monter, prendre de la hauteur, ou descendre tellement bas que ça nous écrase en même temps. La force même du lyrique est une métamorphose de l’épique. Le mémorable ne se décide pas tout seul dans un coin. Il a conquis son statut dans les mémoires.
La place et la chasse
Je devrais dire que je ne conçois mes positions – sur le Lieu qui situe la parole – pas du tout comme un nationalisme étriqué, ni un appel à un essentialisme morbide, ni à une limitation de la capacité exploratoire du sujet créateur vers une extranéité. Mais il pourrait y avoir sous certaines conditions un essentialisme méthodologique, comme il y a un doute méthodologique. La nation est une idée avec quoi nous vivons pour définir nos mémoires collectives, nos allégeances, voisinages, images et valeurs partagées. Ces choses existent. On naît avec. Mais comme il y a un cosmopolitisme clownesque, il y du nationalisme sordide. La passion de l’enracinement ou du dépaysement peuvent tout deux être d’un folklorisme assommant. La singularité d’une œuvre n’est complètement ni d’insularité ni de nomadisme. Elle est densité d’un parcours dans un territoire donné qui fait la part de l’hospitalité et de l’aventure.
Un écrivain aspire à faire cohabiter trois bibliothèques dans son âme : celle de sa tribu, celle de son cœur et celle de l’humanité. Celle de son cœur, cette bibliothèque expérientielle propre, sans elle l’artiste n’est rien. Or son individualité prend source massivement à une culture commune, et au monde qui l’entoure immédiatement. D’où l’importance de la tribu, qu’il doit connaître, pour se connaitre un peu mieux. Enfin il y a la bibliothèque mondiale. Elle est magistralement importante et elle appartient à tous. Évidemment le problème est que cette bibliothèque, tel quel, est un produit de l’Occident colonial. Pour une bonne part. Pire, ce qui n’est pas spécifiquement d’elle (des Asiatiques, des Africains…) arrive souvent chez toi filtré par la réception de l’Occident. Que faire? On ne peut pas la rejeter. D’abord parce qu’elle est remplie de trésors. Ensuite parce qu’elle est déjà là, dans tous les recoins de ta maison. S’il faut résister à son impérialisme unilatéral il faut bien la connaître, intimement la connaître. Elle, s’est déjà constituée, impérialement, jusqu’à ses marges, jusque chez toi. L’Occident est très à l’aise avec l’intégration de l’altérité, parce qu’il a la force. Toi si tu fais la fine bouche, si tu rejettes en bloc, tu te retrouves à essayer de te purifier : schizophrénie paranoïde, c’est tout ce qui t’attend. Surtout si ton anti-occidentalisme se nourrit des fameux poststructuralistes français, alors là, tu es vraiment perdu! Et si tu cherches tes sources seulement chez toi, tu vas bien devoir nettoyer tout ce que tu estimes avoir été corrompu, tu ne te retrouveras pas avec grand-chose. En fait la bibliothèque mondiale – occidentalisée ou pas – tu dois la dévorer, autant que tu peux, mais tu mettras un point d’honneur à rogner son impérialisme du côté des territoires plus éloignées, du côté des mondes que les œillères impériales ont pu te cacher, mais tu n’y mettras pas de l’obsessionnel, tu as autre chose à faire, dont lire des autres bibliothèques et créer à partir de ton carreau de terre aussi. Par ailleurs si tu te nourris “assez” à seulement deux bibliothèque, ce n’est pas mal, les choses se recoupant parfois, les livres se répondant très souvent, ta bibliothèque d’ensemble ne sera pas misérable, tu auras des ressources. On fait de son mieux. Surtout si la seule bibliothèque réelle qu’on a c’est celle de l’université d’état ou de Justin Lhérisson qui a fermé. Il faut simplement ne pas se leurrer sur nos ressources pour ne pas être inauthentique. On aura remarqué que mes références sont pas mal d’Européens, quelques Haïtiens, des Latino-américains. On fait de son mieux, sans trop se torturer. La torture n’est presque jamais féconde. Je répète, le territoire est le point de départ de l’expérience authentique, mais aussi de l’hospitalité, c’est aussi le point de départ de l’errance, c’est le point de départ du retour, c’est point de départ et point de rencontre. D’ici tu dois pouvoir être toi, pour pouvoir de ta voix propre chanter l’exil, pareil à Du Bellay “Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux,/Que des palais Romains le front audacieux”[5], ou bien prêter l’assurance du regard philosophe d’Alberto Cairo “De mon village je vois de la terre tout ce qu’on peut voir de l’Univers…/C’est pour cela que mon village est aussi grand qu’un grand pays quelconque”[6] tu pourras moduler l’inquiétude par Castera que tu croises dans ta ville “Qui habitera avec nous/cet espace mensonger/l’incertitude de ce pays”[7], tu verras avec lui la violence de ta Mer Caraïbe “lib e kalib/ an moun fou/tèt gaye”[8] mais autant par ton cher Valéry “Midi le juste y compose de feux/La mer, la mer toujours recommencée! O récompense après une pensée/Qu’un long regard sur le calme des dieux!”, ces dieux ne sont-ils pas tes propres esprits tutélaires? Ah, non, ils sont pas calmes, ceux-là ! Il faut répondre à Valéry : rappelle toi “les lotions d’Erzulie/Et les effluves du Datura” chanté par Cavé ou bien l’anonyme “Agoué Taroyo”. Mais, n’est-il pas calme parfois le consolateur “Papa Dambala” ? Cherche. Ta mémoire littéraire, tu dois pouvoir y voyager. Jamais comme un colporteur-mendiant qui va là où on lui tend l’aumône, mais comme une maraîchère qui descend chargée des produits du lopin, puis qui remonte avec la quincaillerie que la ville lui donne si la vente était bonne.
Si on traverse les grands poèmes de la littérature mondiale, ce qu’on peut tenir c’est que Ballade du vieux marin, Mignonne allons voir si la rose, la lettre sur mer, Les neuf portes de ton corps, Booz endormi, Poignée de sable, Romancero gitan, Le gardeur de troupeaux, tous, pourront demeurer dans des esprits éparpillés à travers le monde, non seulement parce que continue de se constituer un corpus de littérature mondiale qui parcourt ce monde unifié, mais qu’aussi en amont il a fallu une réception par des individualités plus ou moins malléables plus ou moins rétives chez eux, puis ailleurs. L’Histoire d’un Occident à la fois cannibale et impérialiste, et l’histoire des colonisés violentés mais tout aussi cannibales culturellement, ne suffit pour expliquer que s’instituent en même temps des littératures nationales et des littératures mondiales. Un texte d’un canon national peut devenir mondial parce qu’il manifeste une facette d’un Sujet qui ne peut être traduit par des lecteurs extrêmement différents que parce qu’il se connaît organiquement, qu’il se déploie en sujet viable, en montrant, d’un coup, les parcours qui mènent vers ce Sujet. Ce Sujet concret, en se connaissant, reproduit les conditions de possibilité d’existence dans sa parole, il les montre, il les dit au lecteur, qui décode autant qu’il peut un réseau de sens auquel il peut se connecter et s’identifier partiellement, communiquer avec une âme en ses tréfonds. L’universalité d’un texte est à la fois la bordure de ce Sujet du poème, qui est un être humain que nous pouvons plus ou moins comprendre même dans son étrangeté, mais c’est aussi que cette étrangeté se justifie par sa parole depuis la validité de la vie qu’il porte dans tout son corps et qu’il dépose dans le texte. Parce que ce Sujet est fondé en lui-même, un lecteur tout autre peut se voir en lui. La bordure d’universel abstrait dans le corps du poème (les passions les plus générales, les quelques manières d’être qui se reconnaissent en presque toute culture ou en presque toute culture de notre espace mondialisé) ne peuvent être comprises que parce qu’il y a ce corps, qui présente tout son langage singulier, qui appartient à un temps et un lieu délimité. La multiplicité de ce lieu est évidente, il n’y a pas un paysage haïtien fixe, une âme haïtienne archétypale, mais il existe des traits, des chemins et des manières qui se reconnaissent, ne cessent d’éclore dans l’abondance de nos Chroniques et de nos Fables, comme le souligne Emile Ollivier : “Toutes les histoires du monde sont venues échouer sur le côté de cette île, à la mâchoire de caïman endormi : galions remplis d’or et d’émeraude, navires aux cales chargées de princes bantous, fausses Indes de l’Ouest, anthologie de paysages, encyclopédie de jungles, survivance de peaux cuivrées, créoles, une seule humanité aux prises avec la chaleur des Tropiques et les rivages méphistophéliques du temps”[9].
Selon moi un texte central de la littérature haïtienne, pas forcément le plus beau texte, mais sublime comme texte, c’est mon Pays que Voici d’Anthony Phelps, le lyrisme et l’épique ne font qu’un dedans, c’est le même projet chez Neruda, ou Whitman : “je suis moi et ma blessure, mais je suis tous, tous d’entre vous, et pour ça vous allez sentir quelque chose”[10]. Cette fusion de l’intime et du destinal est une veine qui produit parmi les plus belles réussites de la littérature. Risquant le sentimentalisme sans crainte, brisant la glace de l’incommunicable dans l’espérance. Comme quand Neruda dans l’Ode à l’homme simple nous dit à tous : “ Je vais te raconter en secret/qui je suis, moi/comme ça, à voix haute/tu me diras qui tu es,/combien tu gagnes,/l’atelier où tu travailles,/la mine,/la pharmacie,/j’ai une obligation/terrible,/celle de le savoir,/de tout savoir,/nuit et jour savoir/comment tu t’appelles,/voilà mon métier,/connaître une vie/ne suffit pas,/il n’est pas nécessaire non plus/de connaître toutes les vies,/tu comprends/il s’agit de fouiller,/de racler à fond,/et tout comme dans une étoffe/les lignes ont occulté/par la couleur la trame/du tissu,/moi j’efface les couleurs/et je cherche jusqu’à trouver/le tissu profond,/c’est ainsi que je trouve aussi/l’unité des hommes,/et dans le pain/je cherche/au-delà de la forme :/j’aime le pain, je le mords,/et alors/je vois le blé,/les champs de jeunes pousses,/la verte forme/du printemps,/les racines, l’eau,/à cause de çà,/au-delà du pain/je vois la terre,/l’unité de la terre,/l’eau,/l’homme,/et ainsi je goûte les choses,/et en chacune/je te cherche,/je marche, nage, navigue/jusqu’à te trouver,/et alors je te demande/comment tu t’appelles […].”[11] Ça c’est le genre de réussite d’un poète fondamental, qui peut se permettre d’écrire le Chant général et le Livre des questions.
Les poètes fondamentaux de la littérature haïtienne sont du XXème siècle, où cette synthèse devient organiquement possible “Voici pour ta voix un écho de chair et de sang/noir messager d’espoir/car tu connais tous les chants du monde/depuis ceux des chantiers immémoriaux du Nil”[12]. C’est là qu’on va trouver une assise pour une vraie puissance poétique. Au début ça bégayait. Arrive l’Indigénisme et tout va naître, arrivent les Indigénismes plutôt, avec quelques convergences et nombreuses contradictions comme suggère Michel-Rolph Trouillot dans Jeu de mots, Jeu de classe, et c’est de là que va naître pleinement la littérature haïtienne, véritablement autochtone, pour ne pas dire indigène. Il y avait déjà des choses surprenantes, et c’est remarquable, mais on va passer d’un rasoir imitatif complètement nul, à une tension plus conscientisée de ce qu’est l’imaginaire collectif, dont la question sociale et politique n’est qu’un élément d’une dialectique d’un devenir-Sujet. Voici ce que j’appelle découvrir en soi l’épopée… devenir un sujet qui connaît son histoire… pas une abstraction flottante et hors-sol.
Donc l’épopée c’est la densité d’histoires réelles qu’on a à partager, et le lyrisme lui – qu’on s’imagine faussement être premier – c’est la capacité à faire passer de l’épique dans une voix personnifiée. Si un poème veut et peut atteindre, il s’adresse à plus que lui, il s’adresse à un Nous, pas à un Moi, à un Nous mythique, qui peut faire universel, parce qu’il est entier, particulier et commun. Ça ne veut pas dire que le sujet s’efface, au contraire il s’assume hors biographie. Il se sublime la voix singulière pour en contenir plus. Épique est tout cycle d’actions, de gestes symboliques et de paroles exemplaires, qui mènent, poétiquement, une multitude de gens vers un passé-présent commun, vers ce fondement mythique qui fonde une possibilité d’histoire. Il y faut spécifiquement préserver la tension entre l’imaginaire non-individuel qui traverse un pays surpeuplé de poèmes, et la prise en charge de la parole par cette voix qui porte un nom, celui du poète, et ce, depuis le premier jet passablement extatique, jusqu’aux dernières corrections de virgules.
Pour le poète deux choses importent encore aujourd’hui pour ne pas perdre cette veine : renouer avec le potentiel sous-estimée du narratif, du conte, au sein d’un poème, et jouer suffisamment avec l’identité de celui qui parle pour marquer les ressources que contient une multiplicité d’identités (parfaitement fictives). On voudrait cantonner ces ressources au roman et au théâtre. Ceux qui font du poème une collection d’images, ne savent pas à quel point ils méconnaissent toute l’histoire de la poésie, particulièrement haïtienne, où l’image est toujours au service d’une Histoire portée par une voix multipliée. C’est ce qui rassemble la génération Frankétienne-Castera, et celle d’avant Roumain-Depestre, aucun n’y échappe. C’est pour cela que l’expérimentalisme du Frankétienne-poète reste rigidement contraint par sa conception d’une avalasse de langage qui allégorise éternellement la genèse chaotique de la langue créole dévorant la française. Plus qu’aucun autre, et malgré lui, son obsession est la puissance d’un logos dionysiaque natif-natal, et pas du tout la liberté du génie individuel qu’il aime à prétendre incarner. Castera, Philoctète, Bonel, ou encore le couple Trouillot-Narcisse, et plus récemment la tentative de Guy-Régis dans Powèm entèdi, sont tous plus lucides en ce sens sur ce qu’ils font : une participation à l’être-là du langage et de la vie des haïtiens concrets. Le Krèy bobèch d’Inéma surgit de ce même désir de faire corps avec la réalité sociale et mythique d’un ici-maintenant commun, commun à nous, qui vivons et parlons sous le regard impérial de son Mambo Ilang-Ilang, qu’il invente évidemment, mais que tout haïtien reconnaît immédiatement. La recherche formelle fait corps avec la nécessité de dire la nature du milieu ambiant qui est en devenir avec nous tous. La forme du poème, son style, sa liberté, est l’outil de rehaussement qui défamiliarise le réel-nôtre – que nous perdons sans cesse de vue dans la violence du quotidien – pour le rendre présent.
Urbi et orbi
Parlant d’une fonction politique du poème, par exemple la vertu d’écrire un possible poème sur les massacres de La-Saline, là tout de suite, que ça serve mais que ça fasse sens au-delà de La-Saline, en le faisant, si on réussit, on se situe, et on est dessaisi en même temps. J’écris en liberté en écrivant dans les circonstances qui m’étouffent. Ce n’est pas un hasard qu’un écrivain aussi timide qu’Euphèle Milcé trouve l’un des plus grands moments de son rythme, tout dernièrement, dans sa nouvelle en créole sur le fait divers de la mutinerie de 2019 à la prison de Gonaïves[13]. Il me faudrait dire un peu sur la poétique propre du romanesque après cet exemple. Mais j’ai déjà dit que tout œuvre de langage était poème. Depuis le lieu de son ancrage le texte qui a une puissance poétique doit se ménager un espace de dégagement, mais il ne peut le faire qu’en s’empêtrant dans la poisseuse contingence du monde. Le texte me dépasse bien sûr, mes petites idées ne s’imbriquent pas parfaitement au poème qui se fait. Mais, ce poème a une Situation et un Lieu. Cette situation et ce lieu jugent le poème et le justifient. Sauf qu’ils ne résument pas le poème. La paraphrase impossible du poème, la déterritorialisation du discours, la non-généricité du propos du poème, sont les marques du poème.
L’affinité d’une pensée à son écriture est toujours sous tension. Il peut être élitiste-mystique (le camp Saint-Aude) ou communiste (le camp Roumain), les deux (le camp Trouillot) ; anarque et vassal ; national et empire ; individualiste et ecclésial… et pleins d’autres ceci et pleins d’autres cela. Un poème n’est obligé de rien. Il engage dans une scansion, qui dérape constamment en décrets, puisqu’avant tout le poème cherche son propos en dehors du déjà-dit et fonde sa trouvaille dans une intensité qui doit marquer idéalement au fer.
De la politique de mon poème, disons de la couleur d’un poème idéal, je tiens qu’il est déterminé par un souci du corps social auquel je suis redevable d’exister. Social, ce n’est pas juste la misère en face du luxe obscène, ce n’est pas ça le pur noyau de mon souci, non plus la lutte des classes, oui, c’est aussi tout ça, mais enclavé dans l’affliction humaine, comme question qui perdure, l’élan cassé du spirituel, disons, l’état de Chute – pour parler en chrétien – d’où l’on se relève sanctifié ou dessonné – pour parler en vaudouisant – et puis le champ de l’Utopie qui régule l’espérance, l’action et les rêves. Je dis social, pour dire être-humain intégral, personnes en communauté d’expérience, pour ne pas dire en communion… je dis social, par opposition à une trop grande extension de l’intime, à la simple contemplation d’un Être, ou bien au simple parti pris des choses, et autre esthétismes éthérées… ce qui n’est pas exclure ces choses de mes soucis, mais reconnaître leur secondarité. Donc, le poème veut s’adresser à une communauté, je crois qu’on peut le comprendre.
Ce n’est pas un manifeste ou un essai politique, mais il ne peut que se fonder sur un regard sur le Peuple mouvant, sur ce qui péniblement ramasse une expérience plurielle d’individus liées, le Peuple. Un tel fondement est la conséquence logique de prétendre ou de rêver utiliser la richesse de la langue réelle d’un pays réel, quel que soit l’objet du propos, et le propos s’en ressent, particulier, le texte ne peut qu’aspirer à parler par le Peuple et à y appartenir, manière que sa parole ait une pesanteur, de là où elle se tient. Démagogie serait pourtant de nier la situation, individuelle et isolée, de la syntaxe d’un tel poème, sa charge culturelle et sa tendance à la distinction. Mais l’usage de la distinction n’a pas à être une stratégie de positionnement. D’abord parce que l’élitisme du poème est hyper-individuelle et idiosyncratique, pas d’un petit groupe, jamais seulement, sinon l’écrivain est mauvais ! Voilà ce qui l’arrache brutalement à l’appartenance de classe. Evidemment cet arrachement ne le délivre pas, il peut cependant lui permettre de réaliser son art en pleine conscience, sans mauvaise conscience ni in-conscience.
Sociologiquement le poète est un moins que rien. Son langage ne lui promet appartenance à aucune classe, quelque soit le niveau de langue dont il abuse. De même qu’un proverbe n’a pas de classe sociale en soi, le poème n’est lisible que par qui veut le lire, celui qui lira, ou qui entendra, un quidam. La difficulté à atteindre une population peu alphabétisée et une élite fort peu intéressée à la littérature est un fait. Chose que doit méditer un poète. Par quoi le poème arrive aux oreilles de la communauté ? Ce n’est plus affaire du poème mais d’experts en sociologie et en média. Dans une moindre mesure c’est affaire de compétence sociale du poète qui se doit de vivre hors de sa clique. En gros le poème est prêche dans le désert. Ceux qui passent par le désert savent ce qu’ils y foutent. On peut juste écrire, faire des lectures, s’adresser aux lecteurs comme on peut.
Un poète est contre les meutes, mais pas contre les choeurs. Le poète vise l’excellence et ne se rabaisse pas aux ordonnances des sectes décérébrées de quelques extractions qu’elles soient. Certaines sectes restent plus fréquentables que d’autres, selon ce qu’on entend mener comme vie.
Corps à corps dans les langues
On écrit pour ce qui existe et qui doit exister de beau, pas pour les basses machinations d’un Pouvoir, ni pour caresser les yeux fermés des enfants gâtés qui ne veulent pas voir la sublimité de la laideur qui les entoure. Si la poésie se fait en pratique pour quelques-uns, son idéal est une parole qui s’adresse à la profondeur de tous, d’un “tous” concret, les voisins, les prochains, les camarades… ici, je me vois me heurter – encore et encore – à la question évidente de mon destinataire réel quand je parle, sachant que ce poème, souvent, et beaucoup d’autres du corpus haïtien, sont écrits dans une langue de caste, ou d’étrangers, cette langue française que peu d’Haïtiens parlent, et que de ceux qui le parlent on aurait du mal à se représenter un peuple. Il y a quelques réponses, ou parades, à ce nœud gordien de la langue dans l’histoire littéraire haïtienne. J’en perçois trois, pour aller vite. D’abord parlant strictement de classes, puisque c’est de ça qu’il s’agit, sans parler de l’inexistence d’une véritable école de la république, sans compter ceux qui conquièrent la langue tant bien que mal malgré les obstacles qu’on leur oppose, il suffit aussi d’un peu d’ouïe et de vision pour se rendre compte que la possession du français comme langue-outil et langue-vécue n’est pas simplement cette chasse-gardée de l’élite qu’on s’imagine, pas seulement, élite qui parle très mal français assez souvent d’ailleurs, et que le rapport de tout créolophone avec le français est plus complexe que la simple exclusion-domination d’une élite moralement répugnante, ce qui n’est pas dire que ce rapport n’est pas le rapport majeur mais… qu’on ouvre un peu les yeux par exemple sur l’étrange guilde des peintres de devanture pour commerce, oui, des boutiques, des borlettes, des petits bars, on y lit un français nôtre qui persiste à appartenir à un coin de l’esprit… va-savoir-pourquoi, à côté d’un créole d’autant plus orgueilleux bien sûr de sa souveraineté ; qu’on écoute simplement la musique populaire et l’imbrication du français dans tel meringue, dans telle ballade de chansonnier pourtant créoliste hors pair, etc, etc. Je prends des cas où l’on ne peut douter d’un usage et d’une réception pénétrante par le pays réel de ce qu’est la langue française. Maintenant, ma deuxième réponse concerne l’histoire et l’héritage comme bien commun : nous avons fait une pensée et une littérature en français, nous la continuons, elle est à nous elle aussi. Elle est en devenir avec nous. Ceux qui la firent et la font sont admirables. Il y a là une motivation largement suffisante pour choisir de méditer ce corpus et tenter d’en être. Ce qui a été fait est grand, et devrait continuer à se faire, tant que ces œuvres et ce qu’elles portent en germe nous parlent et sont vivantes en nous. C’est une sorte d’évidence pour l’écrivain haïtien.
À un étranger qui se voudrait bienveillant (ou taquin) qui demande “-Mais pourquoi, vu que tous les Haïtiens parlent créole, continuer à écrire en français?”[14], on répondra avec une brusquerie (trouillotienne) “Votre question n’a pas de sens…”[15]. Précisant que ce partage complexe mais inévitable du créole et du français, rajoutant que “ce serait idiot, voire suicidaire que d’essayer d’effacer d’un revers de main cet héritage.”[16] Cet héritage, cet aspect de notre vie qui nous a été partagé ne peut être mise en doute. Elle fait partie de notre image de nous-même. Enfin, je dirais seulement que pour ce qui est du problème du français comme langue qui exclut et qui nie la véritable langue nationale, la Réponse, qui a lieu dans la littérature massivement et impeccablement depuis au moins Félix Morisseau-Leroy, est bien d’écrire dans les deux langues avec la même exigence, la même brusquerie, le même farouche engagement. Le plus grand art en langue créole n’a de toute façon pas attendu ces poètes-là pour exister, dans les chants, les proverbes et les contes. Le créole s’est donc simplement installé dans la poésie moderne, le roman et le théâtre, comme chez lui, parce que c’est chez lui, et ce que fait le français pendant ce temps ne lui est pas grand-chose, même si on ne peut pas dire que ça lui est rien du tout. Pour ce qui est de la lutte globale pour une reconnaissance sociale totale du créole (dans l’école, l’université, l’administration… et tous les rapports humains) nous avons une tâche immense à continuer. Mais voilà pour ma succincte défense de la langue française et de la langue créole comme lieux d’invention d’une parole proprement haïtienne. Kreyòl pale kreyòl konprann, il faut être soi et être universel, au quadruple. Parce que le “soi”, les plusieurs “soi” que nous sommes sans passe-pour-qui, c’est ce qu’on a pour avancer. Auguste, Jeudi, Noël, Lavoie-Aupont, Fifi, Orcel, Bolivar, Régis, Frankétienne, Trouillot, Cavé, etc, etc, écrivent dans les deux langues. Georges Castera, l’Immense, lui, avait cette particularité de répugner plus que tout à mélanger le créole et le français dans un même texte, ou un même livre. Question de dignité des langues. Question d’épuiser les conditions de subversion intérieure à chaque langue. On ne peut pas les épuiser. Il faut poursuivre, dans la langue de tel ou tel poème. Donc le pidgin franco-créole à l’intérieur de l’œuvre, la confrontation volontariste de nos différentes langues lui paraissait un recul de ce que nous avions déjà accompli, un snobisme ridicule et inefficace. La Créolité lui paraissait un concept sans contenu. Pour lui, il y a la poésie, il y a les langues, le créole, le français, l’espagnol etc. On écrit dans une langue. Dire avec Glissant que toutes les langues seraient plus ou moins créoles, c’est simplement dire qu’elles ont toutes une Histoire, et paradoxalement cela suggère une exceptionnalité du créole (une nature plus exemplairement métissée) vision superficielle, et discutable, de la langue. De ce que je peux comprendre, et sans chauvinisme excessif, la vertu heuristique de la rigueur de Castera est d’une puissance plus radicale et plus utile, comme outil poétique.
Mais ce qui fait la dignité d’une langue se passe en-deçà des positions de principe et de la théorie. La théorie est un moment charnière, au sens où elle n’est qu’une pierre d’appui pour l’action et pour la créativité du temps long qui échoient infinitésimales aux individus. Dont les poètes. Le problème reste posé quand le réel qu’on met dans le poème comprend des scènes de la vie de tous les jours où ces deux langues s’affrontent par des bouches de gens très concrets, de gens en lutte, d’imaginaires en lutte. Il faut tout de même le dire, ou que ça apparaisse. Notre histoire est aussi cet espace où ces deux Furies folles se combattent, avec tout leur bagage de rancœurs, de fierté et de ruse, de sympathie tendre et de haine parfaite. Je crois quand même que cette tauromachie (qui est le taureau, qui le matador?) est féconde à produire en nous un penchant pour la poésie. Du moins en ressentons-nous vivement la scission entre l’être et le langage.
Mais ce n’est pas que du souci métaphysique qu’on découvre dans cette lutte nocturne des langues. Grâce à Dieu. On retrouve le goût palatal pour le burlesque des mots et des phrases que nous nous balançons consciencieusement tous les jours, le goût pour cette désarticulation toujours risquée, quand nous jouons la mécanique du corps grammatical, de la langue maternelle et de la langue adoptive… le plaisir typiquement haïtien à détecter chez soi et chez les autres les fautes de langue n’est pas simplement un penchant pour la distinction élitiste et aliénante, c’est une forme d’amour pour les possibilités de calembours, d’absurde, de folies et de blagues, que nous offre constamment la diglossie. C’est une sorte d’exorcisme de ce qui toujours nous échappe, quand nous voulons de tout cœur y mettre de la tenue, de la clarté, de la puissance et que nous sommes fébriles, confus et impuissants. Le poème fonde sa non-propriété à la communication pure, et sa non-propriété à la signature du poète empirique. Mais c’est au poète empirique qu’il s’adresse, que nous destinataires puissions entendre. Le poème nous force à devenir Sujet à partir d’un donné du langage. Par le travail toujours en cours du poème, nous mettons un espoir dans l’acte d’imprimer sur le langage une force, qui ne peut pas se résumer ni à notre voix, ni à la voix venue d’ailleurs, ni au pis-aller d’une sorte d’imaginaire collectif, mais un de bouillon de tous ces ingrédients.
Vers d’où
En vérité quand nous parlons dans la vie, notre pensée et sa profération précède toute conscience que nous sommes ce-lui qui parle. Ce n’est pas une tragédie mais un fait. Notre conscience réflexive n’est qu’un intermède de nos fonctions automates. Cependant qui nous sommes est réel, et plus encore, parmi qui nous sommes-là. Le jeu du poème est de partir d’une intuition, d’une vérité sensible dont nous héritons et de défaire ce don et de remonter le cours de nos convictions et plus éparses déambulations, pour à la fin séduire un discours qui nous ressemble et qui ressemble à un poème, avec promesse d’un auditeur ami qui s’enchanterait de ces délires.
De l’inspiration (quoique cela soit), le poète du Zarathoustra nous dit qu’ “on ne saurait en vérité se défendre de l’idée qu’on n’est que l’incarnation, le porte-voix, le médium de puissances supérieures […] « quelque chose » qui nous ébranle, nous bouleverse jusqu’au plus intime de notre être.”[17] mais ailleurs il affirme plus royalement encore que “l’imagination du bon artiste, ou penseur, ne cesse pas de produire, du bon, du médiocre et du mauvais, mais son jugement, extrêmement aiguisé et exercé, rejette, choisit, combine.[18]” Il n’est pas sûr qu’il y ait contradiction. Il y a du transcendant même dans le plus militant ou ludique ou libertin poème qui marche, comme les îles de Philoctète ; mais il y a toujours l’immanence du labeur et de la contingence, dans le plus mystique joyau qui sort “tout nu” du cœur.
Ce que fait le poème et ce qu’on en fait – dans la réussite du texte – dépassent notre maîtrise des règles de convenances de la jolie petite poésie du dimanche. Tandis que la grande poésie, on voit bien qu’elle est grande parce qu’elle déborde. C’est un signe plus ou moins fiable que nous ne sommes pas en train de faire n’importe quoi, qu’on se sente débordé.
Une nouvelle poétique – comme un mitage anarchique de baraquements sur les épaules d’une ville qui tient à peine sur ses jambes – ne peut tenir que par d’anciennes fondations, qui s’évanouissent en pénétrant la matière de la nouvelle architecture. Une ancienne poétique ne peut persister que si elle s’informe du mouvement imprévisible qui mène la dispersion des destinataires.
La méthode est de suivre la trace de ce qu’il est urgent de dire maintenant, à tâtons ou par sauts, de suivre des signes et de saluer quand on rencontre des ombres, des esprits et des gens. Faire un poème en pays haïtien, c’est faire un poème dans le lieu que nous avons élu et qui s’est institué pays. Le poème est une partie de l’engagement envers ce lieu qu’on a en main parce qu’on est tombé au sol sur la route d’une existence et qu’on empoigne la terre pour se relever. Ce n’est pas politique au sens simpliste, mais politique au sens de vie digne, en face à face, en dialogue, aspiration à une décence, une attention, une probité. Parfois dans la déchéance et la transgression. Tel que nous sommes ici, le poème ne peut être qu’intensément ce qu’il est par nature, un combat, un assaut de grenadiers pieds nus, épaules contre épaules, qui se portent en avant en chantant vers la vie et la mort.
___________________________
[1] En 2019 pour Café-Philo, j’avais préparé ce texte, en reprenant quelques pensées anciennes sur la poésie. Je l’ai remanié, mis à jour, et un peu raccourci.
[2] Aimé Césaire, Sur la poésie nationale.
[3] Ibid.
[4] J’exagère peut-être un peu. Le policier c’est courant d’y trouver un ancêtre dans le mythe d’Oedipe, mais il faut le scientisme moderne pour avoir la science-fiction, sauf qu’en tirant un peu par les cheveux on peut voir l’épisode du Cheval de Troie de l’Iliade comme de la science-fiction militaire d’époque. Et si on aborde la magie ou la cosmogonie comme de la proto-science alors on ne manquera pas de précurseurs en poésie.
[5] Du Bellay, Les regrets.
[6] Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux, et autres poèmes d’Alberto Cairo.
[7] Georges Castera, Les cinq lettres,
[8] Georges Castera, Rèl.
[9] Émile Ollivier, Mille eaux, cité in Dalembert, Trouillot, Chemla, Haïti, une traversée littéraire, Presses Nationales/Culturesfrance/Philippe Rey, p. 88
[10] J’ai noté ça fait longtemps cette citation de Neruda, mais pas source. Je l’ai accompagné de la remarque de Roberto Bolaño, selon qui tous les écrivains latino-américains avaient un compte à régler avec Walt Whitman. Une remarque que j’estimais lumineuse.
[11] Pablo Neruda, Odes élémentaires.
[12] Jacques Roumain, Bois-d’ébène.
[13] Euphèle Milcé, Danfans Malè.
[14] Dalembert, Trouillot, Chemla, Haiti, une traversée littéraire, Presses Nationales/Culturesfrance/Philippe Rey, p. 49
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Nietzsche, Ecce Homo, Garnier Flammarion.
[18] Nietzsche, Humain trop humain, tome I, Gallimard
______________
PS: SiBelle Haïti veut produire un travail de qualité dans le secteur, et pour cela, souhaite vivement financer son programme pour qu’il puisse durer. Si vous êtes intéressés à contribuer ou à aider, envoyez un mail à sibellehaiti@gmail.com, notre équipe s’entretiendra avec vous pour savoir comment vous pouvez le faire.
N’hésitez pas à aimer nos pages Facebook, Twitter et Instagram, à partir de ces liens :
https://www.facebook.com/SiBelleHaiti/
https://twitter.com/SiBelleHaiti?s=08
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1w2simhemzyle&utm_content=6j1ixsn