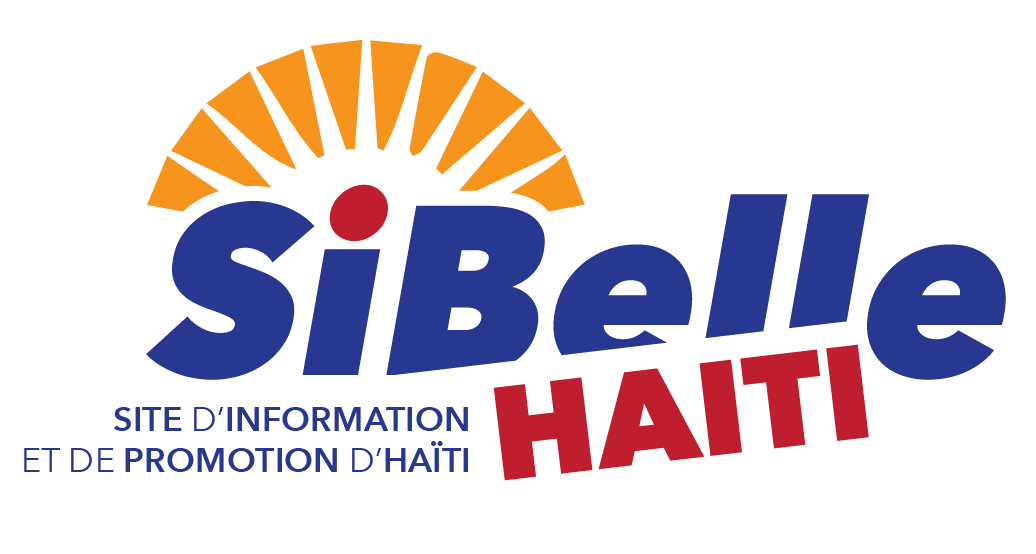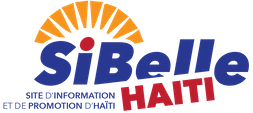Par Mérès Weche
Dans mon enfance, il avait fallu à mon père, ce cultivateur et spéculateur en denrées, beaucoup de livres de café pour me procurer des livres d’étude et de lecture, car ça marchait bien cette culture et ce négoce à Beaumont. A Jérémie, j’étais donc ce fils de « bourgeois paysan » , qui ne manquait pas de livres que lui procuraient les champs de caféiers et la balance de son père.
Il me faut tout de suite faire la différence entre un « bourgeois paysan » et le petit-bourgeois des grandes villes, conformiste et sans idéal, se préoccupant de son seul confort matériel. J’ étais ce produit d’un bourg, comme cela s’entendait au Moyen Âge, c’est-à-dire né dans une habitation de campagne à usage privé.
Le mot « café » avait un autre sens que je ne connaissais pas encore. Tout ce que je savais, c’était que mon père plantait et pesait du café, tandis que ma mère et ma grand-mère coulaient ce précieux breuvage dans la cuisine, dans une longue passoire de toile appelée grèg. Cela coulait de source qu’il y avait dans les grandes villes un lieu nommé café, ce repaire des petits-bourgeois en quête de sensations fortes. Pour moi, jusque-là, il n’y avait pas meilleur plaisir que celui procuré par un gros godet de café, fraîchement grillé, à la manière de Tante Sylvia.
Me voici, quelques années plus tard à Port-au-Prince, où le café n’est autre que ce lupanar à la rue du Champ-de-Mars ou à la rue Américaine. L’espace d’un cillement, une nana dominicaine vous montre sa face-café-au-lait, en attendant de vous proposer sa fesse-passe-partout, en échange de quelques piastres.
Cet ami, de regrettée mémoire, qui m’avait fait découvrir cette nouvelle dénomination du café, était animé de bonnes intentions, car il croyait devoir m’initier aux mœurs de la ville, me faire devenir comme lui un petit-bourgeois, qui se la coule douce à Port-au-Prince, avec l’argent du café durement gagné par son père à Beaumont. J’avais la tête qui tournait, au point d’avoir vu à l’envers la « face » de cette nana dominicaine, en y lisant « café », comme dans une jolie anagramme. Obsession, je le jure, mais je ne voulais, en aucun cas, brûler ainsi le courage de mon père. À défaut de bourse, cet objet bourgeois, je tâtais ma poche pour m’assurer que les sous qu’il m’avait donnés étaient encore là, et qu’ils allaient y rester, pour l’achat de mes livres au moment opportun.
Aujourd’hui, le café de Beaumont n’est plus. Il en est de même des cafés de la rue Américaine et du Champ-de-Mars. Cependant, il reste quelque chose de cette culture que passionnait mon père, ne seraient-ce que ces livres d’antan, aux riches enluminures, qui ont servi à meubler ma mémoire de « bourgeois paysan » et qui se « livrent » encore à moi, par-delà les mers.